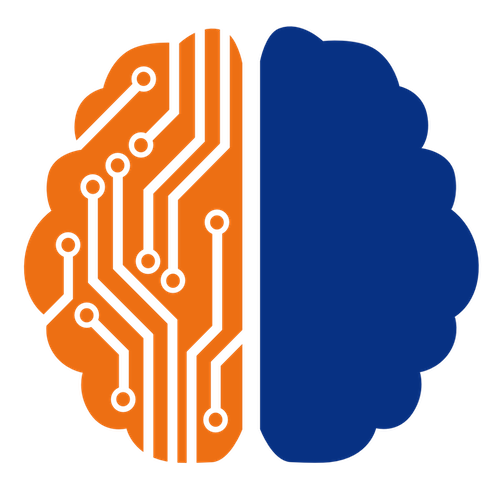Décrypter les indications sur les cartes SD et microSD
Les cartes SD et microSD sont devenues omniprésentes dans notre quotidien numérique. Qu’il s’agisse d’un appareil photo, d’un smartphone, d’une caméra embarquée ou d’une console portable, ces petits morceaux de plastique sont des concentrés de technologie. Pourtant, leur surface affiche souvent une série de symboles et de sigles qui peuvent paraître opaques.
Si tu n’as pas le temps de lire, voici une explication condensée en vidéo TIKTOK
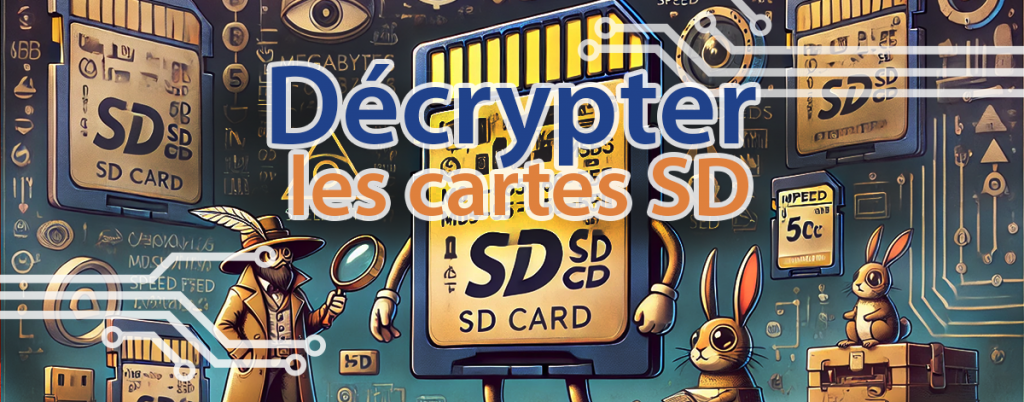
1. Un peu d’histoire : de la carte SD à la microSD
L’histoire commence à la fin des années 1990. Trois entreprises – SanDisk, Panasonic et Toshiba – s’associent pour créer un nouveau format de carte mémoire. Leur but : offrir une alternative plus sécurisée et plus performante que les MMC (MultiMedia Cards), alors en usage dans les appareils numériques.
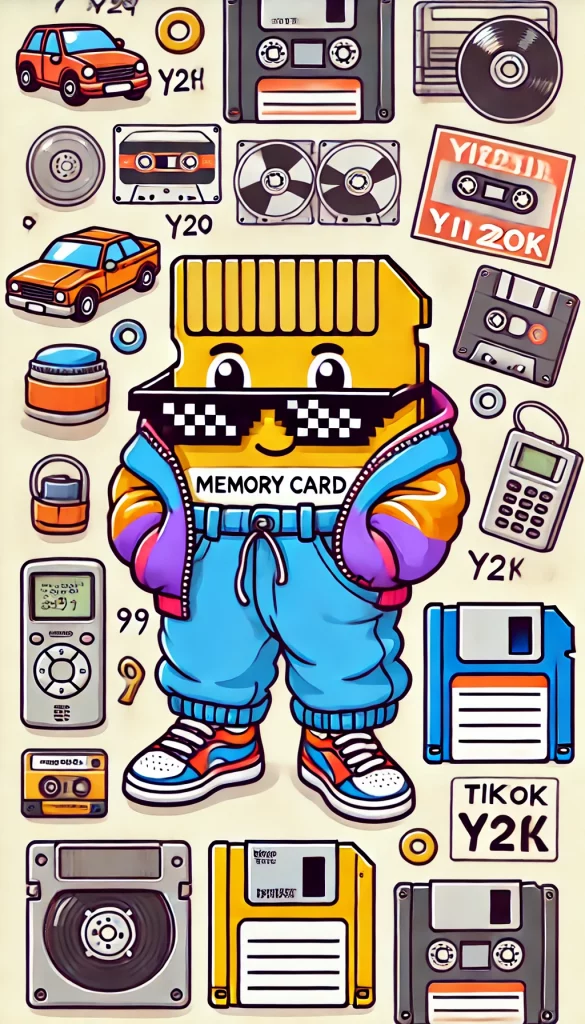
C’est ainsi que naît, en 1999, la carte SD (Secure Digital). D’abord au format « standard », elle évolue très vite pour répondre à la miniaturisation croissante des appareils électroniques. En 2005, apparaît donc la carte microSD, initialement baptisée « TransFlash ». À peine plus grande qu’un ongle, elle deviendra en quelques années un standard incontournable dans les téléphones portables, drones, caméras d’action et autres appareils embarqués.
Ce qui rend ces formats particulièrement robustes, c’est leur capacité à évoluer sans changer leur gabarit physique. Au fil des années, les cartes SD et microSD ont vu leurs capacités et performances augmenter considérablement, tout en restant compatibles avec des milliers de dispositifs déjà existants. Cette évolution a été rendue possible grâce à un travail d’ingénierie normatif très fin, piloté par la SD Association, l’organisme qui définit les standards techniques.
2. Capacité et classification : SD, SDHC, SDXC, SDUC
Le premier critère à observer sur une carte SD ou microSD est sa capacité de stockage, qui conditionne en partie les technologies internes qu’elle utilise.
Pour des raisons de compatibilité et de système de fichiers, les cartes sont classées selon les standards suivants :
| Format | Capacité | Système de fichiers |
|---|---|---|
| SD | Jusqu’à 2 Go | FAT16 |
| SDHC | 4 Go à 32 Go | FAT32 |
| SDXC | 64 Go à 2 To | exFAT |
| SDUC | 2 To à 128 To | exFAT |
Ces appellations ne sont pas simplement commerciales : elles dépendent du système de fichiers utilisé et du type de contrôleur embarqué. Par exemple, une carte SDXC ne pourra pas être lue par un appareil ne gérant que le FAT32, même si le format physique est identique. À noter que la norme SDUC est encore marginale sur le marché, en raison de son coût et de la rareté des appareils compatibles.
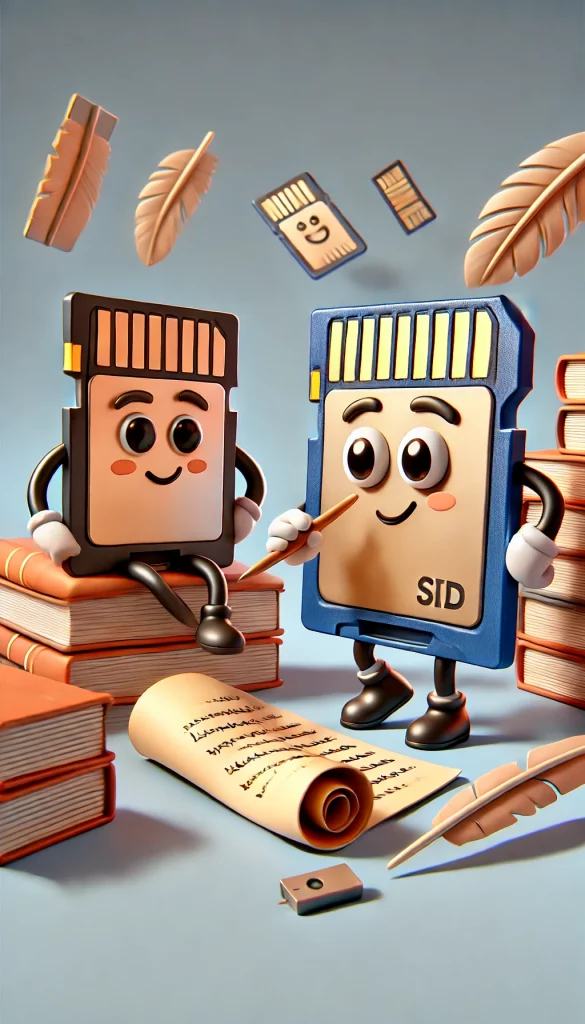
Il est donc essentiel de ne pas se fier uniquement à la capacité affichée, mais de s’assurer que le dispositif dans lequel la carte sera insérée prend en charge le bon format (SDHC, SDXC, etc.).
3. Speed Class : la base des vitesses minimales
Les premières cartes SD étaient relativement lentes. Pour standardiser les performances minimales acceptables, la SD Association a introduit dès les années 2000 le concept de Speed Class, souvent représenté par un chiffre dans un cercle.
Ce chiffre indique la vitesse minimale d’écriture séquentielle soutenue, exprimée en mégaoctets par seconde (Mo/s) :
- Classe 2 : ≥ 2 Mo/s
- Classe 4 : ≥ 4 Mo/s
- Classe 6 : ≥ 6 Mo/s
- Classe 10 : ≥ 10 Mo/s
Ces vitesses sont suffisantes pour un usage basique : photographie simple, enregistrement vidéo en basse résolution, lecture de fichiers audio. Mais elles sont rapidement devenues insuffisantes pour des usages modernes comme la capture vidéo en haute définition, d’où l’apparition d’autres classes plus spécifiques.
4. UHS (Ultra High Speed) : montée en puissance
La norme UHS (Ultra High Speed) est venue compléter les Speed Class en offrant une bande passante bien plus élevée pour les cartes SDHC et SDXC. Elle s’appuie sur des améliorations à la fois logicielles (protocole de transfert) et matérielles (lignes de communication supplémentaires).
Il existe aujourd’hui trois générations UHS :
- UHS-I : jusqu’à 104 Mo/s
- UHS-II : jusqu’à 312 Mo/s
- UHS-III : jusqu’à 624 Mo/s
Les cartes UHS-II et III disposent d’une deuxième rangée de contacts visibles au dos. Si une telle carte est insérée dans un lecteur UHS-I, elle fonctionnera, mais à vitesse réduite.
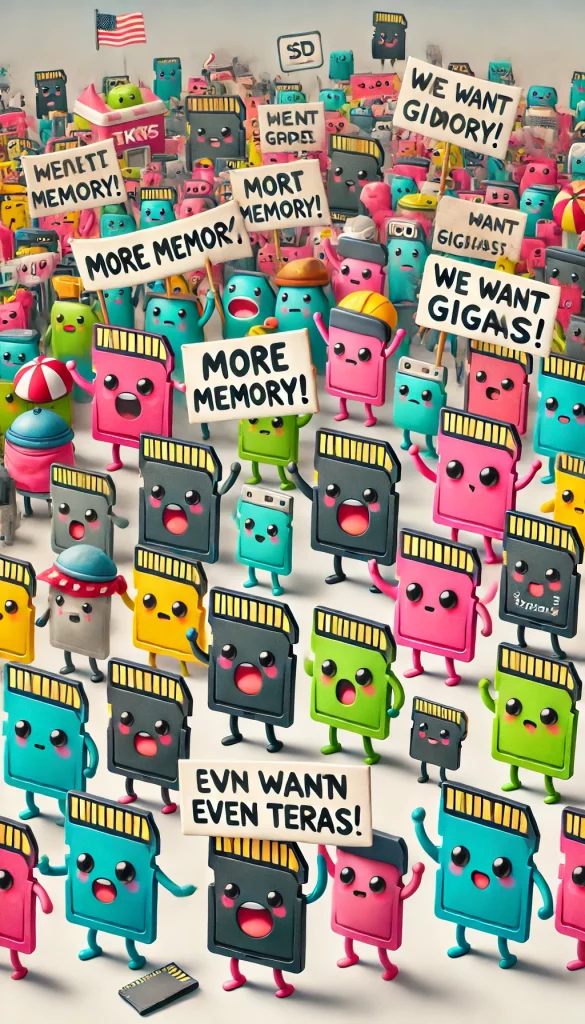
Une autre notation UHS, souvent affichée dans un « U », indique la vitesse d’écriture minimale soutenue :
- U1 : ≥ 10 Mo/s
- U3 : ≥ 30 Mo/s
Ce marquage est particulièrement important pour les vidéastes utilisant la 4K, qui nécessite un débit constant non négligeable.
5. Video Speed Class (V) : la norme dédiée à l’enregistrement vidéo
Face à la diversification des formats vidéo (Full HD, 4K, 6K, 8K, RAW), la SD Association a introduit la Video Speed Class, représentée par un « V » suivi d’un nombre.

Chaque valeur indique la vitesse minimale d’écriture soutenue, en Mo/s :
- V6 : ≥ 6 Mo/s
- V10 : ≥ 10 Mo/s
- V30 : ≥ 30 Mo/s (recommandé pour la 4K)
- V60 : ≥ 60 Mo/s (pour la 6K)
- V90 : ≥ 90 Mo/s (pour la 8K et les formats RAW)
Contrairement aux Speed Class historiques, la norme V impose des tests rigoureux pour garantir que la carte peut maintenir ce débit sur de longues durées, condition indispensable pour des flux vidéo sans interruption.
6. Application Performance Class (A1, A2) : pour les systèmes mobiles
Dans le contexte des smartphones et tablettes, où les cartes microSD peuvent être utilisées comme mémoire d’extension système, il ne suffit plus de mesurer des vitesses séquentielles. Il faut évaluer la capacité à gérer des accès aléatoires à de petits fichiers, fréquents lors du lancement d’applications.
C’est là qu’intervient la classe de performance applicative, notée A1 ou A2. Elle s’exprime en IOPS, c’est-à-dire Input/Output Operations Per Second – un indicateur qui mesure le nombre d’opérations de lecture/écriture pouvant être effectuées chaque seconde.
- A1 : ≥ 1500 IOPS en lecture / ≥ 500 IOPS en écriture
- A2 : ≥ 4000 IOPS en lecture / ≥ 2000 IOPS en écriture
La norme A2 introduit également l’usage de mécanismes comme le command queuing et le cache host-managed, qui exigent un support matériel et logiciel approprié. Une carte A2 dans un appareil non compatible fonctionnera, mais avec des performances similaires à une A1.
7. Lecture, écriture, performances réelles
Il faut distinguer les vitesses théoriques maximales, souvent mises en avant par les fabricants (ex. « 100 MB/s Read »), des vitesses soutenues garanties par les classes (U1, V30, etc.).
- La vitesse de lecture est généralement plus élevée que celle d’écriture.
- Les vitesses affichées sont obtenues en conditions de test idéales (fichiers de grande taille, accès séquentiels, contrôleur optimisé).
- En usage réel, surtout avec de petits fichiers, les performances peuvent être nettement inférieures.
Pour des applications critiques (vidéo RAW, photo en rafale, jeux), il est recommandé de se référer aux classes U, V ou A plutôt qu’aux chiffres marketing.

8. Format physique, compatibilité et rétrocompatibilité
Il existe deux principaux formats physiques : SD (32 x 24 mm) et microSD (15 x 11 mm). Les deux peuvent adopter les mêmes standards (SDHC, SDXC, UHS-I, etc.) et présentent des performances identiques à génération équivalente.
Côté compatibilité :
- Une carte microSDHC peut être utilisée dans un lecteur SDHC ou SDXC via un adaptateur.
- Une carte SDXC ne fonctionnera pas dans un appareil limité au SDHC, même si les dimensions sont les mêmes.
- Une carte UHS-II fonctionnera dans un appareil UHS-I, mais avec les limitations de cette norme.
La rétrocompatibilité est une priorité des concepteurs de cartes SD, mais elle a ses limites techniques liées aux fichiers systèmes et aux interfaces électroniques.